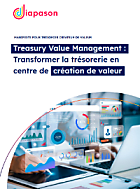DossierDaf, emparez-vous du juridique!
La multiplication des textes de loi ces dernières années force le Daf à jongler avec des impératifs juridiques toujours plus nombreux, notamment dans les PME et ETI, majoritairement dépourvues de responsable juridique. Comment gérer efficacement ces questions? Quand faire appel à des spécialistes?

Sommaire
- Le Daf, acteur central sur les questions juridiques
- Tour de contrôle
- Un besoin croissant de cautions juridiques
- La fiscalité, un des grands champs d'action du Daf
- Allocation des ressources
- 3 questions à Philippe Dupuis, Daf en charge du juridique
- Conseil externe et juriste interne : le duo gagnant
- Analyser les besoins juridiques
- Transférer le risque sur le cabinet externe
- Le juriste d'entreprise, un avantage compétitif
- [Témoignage] Sam Outillage recrute un responsable juridique
- Quels impératifs juridiques pour le Daf en 2014?
- 1. Droit fiscal
- 2. Droit social
- 3. Droit économique
- [Interview d'Olivier Chaduteau, Day One] " Le Daf et le directeur juridique ne doivent pas être en concurrence "
1 Le Daf, acteur central sur les questions juridiques
Le Daf d'aujourd'hui ne se contente plus de surveiller la comptabilité et de faire son reporting. Au fil des années, son rayon d'action s'est considérablement élargi. Sa fonction éminemment transversale est désormais le point de convergence de l'ensemble des questions juridiques relatives tant à la vie quotidienne de l'entreprise (droit des contrats, fiscalité, ressources humaines...) qu'aux opérations exceptionnelles (cession, rachat, fusion...).
C'est particulièrement le cas dans les PME et les ETI dont l'organigramme est réduit au strict minimum. "Le Daf a une fonction stratégique car toutes les composantes de l'entreprise ont une traduction chiffrée. Par conséquent, s'il n'est pas entouré d'un responsable juridique et d'un responsable RH, il a généralement un rôle de référent pour ces questions", résume Frédéric Cohen, avocat associé spécialiste en droit des sociétés et M&A chez Courtois Lebel.
Et cette tendance semble se renforcer. "Depuis quelques années, on voit de plus en plus d'entreprises dont l'organisation est simplifiée, note Kim Campion, avocat associé spécialisé en droit social au sein du même cabinet. Dans nombre de filiales françaises de sociétés internationales, la direction juridique est assurée dans les faits par le Daf, voire par le DRH. En revanche, on constate que la fonction de directeur juridique reste encore bien présente dans les grandes sociétés françaises."
2 Tour de contrôle
Quel que soit l'organigramme de l'entreprise, le Daf n'échappe pas aux questions de droit. "Le juridique est fournisseur de tous les services de l'entreprise, analyse Carole Gauthier-Longeard, Daf de la société Du Pareil... au même (mode pour enfants, CA: 230 M€). À partir du moment où le Daf veut avoir une vision transversale de l'entreprise, il doit obligatoirement passer par la case juridique."
Pour Philippe Dupuis, Daf de la société HR Path, "il est très important d'avoir une vision juridique d'ensemble car le droit est un élément très impactant pour l'entreprise. Selon moi, le Daf doit avoir un rôle d'alerte. C'est une tour de contrôle." Reste que son implication dans les questions juridiques sera fonction de la taille, de l'organisation et de l'activité de l'entreprise, mais aussi de sa formation initiale et son goût personnel pour le droit. Le périmètre juridique du Daf est donc fortement variable. "Il y a autant de situations possibles qu'il y a de directeurs financiers", résume Kim Campion.
3 Un besoin croissant de cautions juridiques
Christophe Gérault est Daf depuis 16 ans au sein de la société parisienne Ketchum (CA: 10 M€, groupe Omnicom), spécialisée dans les relations presse et relations publiques. Selon lui, le métier de Daf a évolué ces dernières années vers davantage d'implication juridique. "On doit toujours plus se border, souligne-t-il. Il faut que nous soyons irréprochables parce que les gens avec qui nous traitons (clients, salariés, actionnaires...) ont un meilleur accès à l'information. Parallèlement, les obligations en matière de reporting et de contrôle se sont intensifiées." Conséquence: le Daf a un besoin croissant de cautions juridiques. "Je suis en relation avec des juristes spécialisés dans chaque domaine de compétence: ressources humaines, fiscalité...", précise-t-il enfin.
Parmi les opérations juridiques courantes, l'une des plus chronophages pour le Daf est la centralisation et la validation de l'ensemble des contrats établis par l'entreprise. Dans une PME ou une ETI sans responsable juridique, il pourra même prendre en charge la rédaction sur la base de contrats types. Pour sa part, Carole Gauthier-Longeard collabore avec une directrice juridique. "Je fais valider l'ensemble des contrats par la fonction juridique qui reste à l'affût de l'évolution de la jurisprudence, souligne-t-elle. Mon rôle sera avant tout de mesurer les risques financiers. C'est notamment le cas dans le cadre de contrats de distribution."
En matière de relation commerciale, l'affaire se complique en cas de litige. "Si le client a une requête légitime, nous essayons de gérer l'affaire en interne, sinon je m'appuie sur un avocat qui va se charger des procédures, détaille Christophe Gérault. S'il s'agit d'un litige relatif à un marché public, j'ai recours à un avocat spécialisé en droit public. Dans tous les cas, l'avocat a besoin d'un maximum d'informations. Cela nécessite un long travail de préparation pour le Daf."
4 La fiscalité, un des grands champs d'action du Daf
La fiscalité constitue un autre champ d'intervention juridique du Daf, car celui-ci est responsable des déclarations et en relation directe avec l'administration fiscale. En fonction de l'activité de l'entreprise, la tâche peut prendre une ampleur significative. "Payer la CFE / CVAE sur 550 magasins, cela prend du temps", note Carole Gauthier-Longeard. La Daf de l'enseigne Du Pareil... au même, présente à l'international, doit également gérer les chartes de prix de transfert.
Plus exceptionnellement, le Daf peut avoir à gérer un contrôle fiscal ou d'Urssaf, en France ou à l'étranger. "Nous avons récemment eu un contrôle fiscal que j'ai géré de A à Z, c'est très consommateur de temps", témoigne Carole Gauthier-Longeard. "S'il y a un contrôle, le Daf est en première ligne, mais cela se passe bien en général, sauf en cas de litige important, rassure Christophe Gérault. Par ailleurs, les reportings étant de plus en plus détaillés, les choses sont faciles à expliquer et à justifier. De plus, les commissaires aux comptes sont là pour jouer les garde-fous."
Dans les structures les plus modestes, le Daf porte aussi la casquette de responsable des ressources humaines et prend en charge la gestion sociale des salariés (modification des contrats de travail, formation, congés payés, rupture conventionnelle...).
5 Allocation des ressources
Pour des raisons économiques évidentes, le Daf limite son recours aux professionnels du droit au strict nécessaire. "Je fais appel à des juristes extérieurs ou des avocats en cas d'opération spéciale comme un rachat ou pour les questions internationales, par exemple, quand nous devons échanger avec le fisc espagnol ou italien", précise Carole Gauthier-Longeard.
Le recours à un avocat peut être également requis lorsque la partie adverse est accompagnée d'un professionnel du droit. C'est notamment le cas lors d'une cession ou en matière de droit social (contentieux avec un salarié). "C'est essentiellement une question de bonne allocation des ressources, analyse Frédéric Cohen. À partir du moment où le temps nécessaire, la complexité du dossier et l'enjeu en termes de risques sont significatifs, l'entreprise fait appel à un avocat. De même, si l'opération mobilise plusieurs spécialités à la fois (droit immobilier, droit des sociétés, droit fiscal...), elle risque d'être très chronophage, au détriment des autres missions dont le Daf a la responsabilité."
6
Contrats, fiscalité, cession, rachat... Le rayon d'action du Daf dépasse largement le domaine du bilan et du compte de résultat. En particulier dans les PME et les ETI dont l'organigramme est réduit au strict minimum. Tour d'horizon.
7 3 questions à Philippe Dupuis, Daf en charge du juridique
En l'espace de quelques années, HR Path a réalisé successivement plusieurs opérations de croissance externe. Or votre entreprise ne compte pas dans ses rangs de responsable juridique. En tant que Daf, quel a été votre rôle?
Dans ces opérations, le montage du dossier d'acquisition a été sous-traité à un avocat spécialisé. Mon travail a surtout consisté à être présent à chaque étape du processus. En tant que Daf, je relis notamment l'ensemble des conditions du contrat. Il faut bien comprendre qu'un rachat, c'est un travail d'équipe entre le cédant, l'acquéreur et les avocats des deux parties. C'est compliqué car très engageant. Il faut déterminer si le cédant reste dans l'entreprise et si oui, à quelles conditions, fixer le prix d'acquisition, etc. Il y a beaucoup de points sur lesquels statuer. Souvent, on dit qu'un rachat dure de six mois à un an. Mais en ce qui nous concerne, nous n'avons jamais mis plus de trois mois.
Lire aussi : Nominations : 6 Daf repérés ce vendredi 20 juin
Le Daf est-il central dans ce type d'opération?
Oui, le Daf joue un rôle important. Mais il faut faire attention. L'acquisition est une opération très engageante, il faut se faire aider. Le Daf a besoin d'un accompagnement, d'un garde-fou. Il lui faut un juriste ou un avocat spécialisé qui va rédiger la trame du contrat d'acquisition et l'alerter sur les zones à risques.
Vous avez également opéré plusieurs fusions. Comment avez-vous procédé?
En effet, nous avons repris l'an dernier le groupe ICRH qui comptait sept sociétés. J'en ai fusionné six au rythme d'une par mois. J'ai tout fait moi-même. Si nous avions sous-traité ce travail, cela nous aurait sans doute coûté 30 ou 40 000 euros. C'était un dossier technique, mais cela m'a permis de progresser.
Pour ces fusions, j'ai eu recours à la transmission universelle de patrimoine (TUP). Il suffit de faire un procès-verbal expliquant que l'on va procéder à une TUP, puis de le déposer aux services fiscaux, d'arrêter les comptes et de remonter la balance dans la société absorbante. La difficulté dans ce type d'opération, c'est que l'on retrouve dans la société mère tout le magma des sociétés qui ont été absorbées.
8
Délégation de pouvoirs et responsabilité pénale
En tant que salarié, le Daf n'engage pas sa responsabilité. Sauf en cas de délégation de pouvoirs, qui constitue une délégation de responsabilité civile et pénale. "Il faut alors que le périmètre de la délégation soit précisément défini: circonscrire l'exposition en termes de responsabilités pour permettre d'exercer effectivement la mission conférée par cette délégation, souligne Frédéric Cohen, avocat associé au cabinet Courtois Lebel. Par exemple, si le Daf est responsable de la sécurité d'une usine, il doit pouvoir ordonner les mesures de mise en conformité qui seraient prescrites par un inspecteur du travail."
Pour engager la responsabilité pénale personnelle du Daf en l'absence de délégation de pouvoirs, il faudrait que sa faute soit détachable de l'exercice normal de ses fonctions et démontrer l'élément intentionnel de l'infraction commise. À défaut, on parlera plutôt d'erreur professionnelle.
Chez HR Path, les questions juridiques sont gérées par le Daf, Philippe Dupuis. Il témoigne sur les implications de cette mission.
9 Conseil externe et juriste interne : le duo gagnant
"Le droit est présent partout. Le besoin juridique des entreprises est en croissance", déclare Denis Musson, président du Cercle Montesquieu (rassemblant des responsables juridiques d'entreprises de toutes tailles) et directeur juridique du producteur de minéraux industriels Imerys. Pourtant, la France ne compte aujourd'hui que 16 000 juristes d'entreprise (source: Association française des juristes d'entreprise, AFJE). Les entreprises préfèrent souvent s'adresser à des cabinets d'avocats externes ou à leurs experts-comptables. Quelle est la bonne stratégie: recruter un responsable juridique ou externaliser cette fonction?
10 Analyser les besoins juridiques
La première chose à faire consiste à analyser minutieusement les besoins juridiques de l'entreprise: quelle est la fréquence d'utilisation de la fonction juridique? S'agit-il d'une entreprise exposée au risque contractuel? Son secteur est-il très réglementé?
Si un grand nombre d'entreprises font le choix d'externaliser la fonction juridique, c'est avant tout parce qu'elles n'ont pas besoin d'un juriste à temps plein. Dans ces cas-là, Denis Musson évoque la possibilité de partager un juriste entre plusieurs PME. "Cela permet de bénéficier de l'expérience plus large d'un juriste qui a la connaissance de plusieurs entreprises confrontées souvent aux mêmes challenges", observe-t-il.
Par ailleurs, selon Marie Duverne-Hanachowicz, avocate associée au sein du cabinet Lamy Lexel, faire appel à un cabinet d'avocats peut aussi permettre de "mieux faire passer le message": "Sur certains secteurs, comme la distribution, il peut être difficile de concilier un juriste interne avec les équipes opérationnelles qui ne comprennent pas, par exemple, les exigences en termes de conditions générales de vente."
Ce sont souvent des problématiques de croissance, notamment internationales, qui poussent les entreprises à recruter un responsable juridique. À l'image de Delphine Delvert-Montigny, actuelle directrice juridique de l'équipementier automobile français FSD, qui est arrivée dans le groupe comme juriste il y a 12 ans: " La société dépassait le stade de la PME, avec un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros et un effectif légèrement inférieur à 2000 salariés. Après avoir développé l'aspect commercial, le groupe était confronté à des problématiques de stratégie touchant le juridique." Les entreprises internalisent la fonction juridique lorsque l'activité se complexifie et que les risques augmentent. "Toutes les sociétés qui ont des problématiques de développement ont besoin d'une assistance juridique pour être accompagnées à l'international ou simplement pour rechercher des moyens financiers", pense Patrick Bignon, fondateur de Bignon De Keyser, cabinet de conseil en stratégie dédié aux professions juridiques.
11 Transférer le risque sur le cabinet externe
Mais recruter un responsable juridique ne veut pas dire qu'on se passe totalement d'un conseil externe. Très souvent, les juristes internes travaillent main dans la main avec les cabinets externes. "Le juriste interne joue aussi de rôle d'acheteur, de sourceur de compétences extérieures", note Christophe Roquilly, professeur de droit à l'Edhec Business School, directeur du centre de recherche LegalEdhec et codirecteur du LLM Law & Tax Management.
Les cabinets spécialisés sont en effet incontournables pour traiter des sujets complexes. "Les juristes font appel à nous pour des opérations exceptionnelles comme des levées de fonds ou des acquisitions, pour les contentieux, mais aussi pour les sujets sur lesquels ils peuvent être limités en termes de compétences, comme le droit social ou fiscal", rapporte Marie Duverne-Hanachowicz. En effet, la fiscalité évolue chaque année: difficile de suivre s'il faut également gérer en parallèle de multiples questions juridiques. "Les fiscalistes internes devraient être en formation tout le temps pour suivre les nombreuses évolutions. En cabinet, nous bénéficions d'une formation continue", explique Stéphane Bouvier, avocat fiscaliste chez CMS Bureau Francis Lefebvre.
Les entreprises font également appel à des cabinets externes en cas de surcharge de travail. Surtout, s'offrir les services d'un conseil juridique externe permet de transférer le risque. "Un directeur juridique ne s'engage pas sur des questions qu'il ne maîtrise pas. Il s'entoure donc de conseils externes pour se protéger. Ainsi, en cas de problème, ce n'est pas lui qui est tenu pour responsable", souligne Stéphane Bouvier. La meilleure stratégie n'est ni d'opter pour un juriste interne ni de choisir un conseil externe, mais de mettre en place une combinaison des deux.
12 Le juriste d'entreprise, un avantage compétitif
Pourtant, un juriste d'entreprise, en dialoguant avec les équipes, peut réussir à se positionner comme un "business partner" et montrer tous les avantages qu'il apporte. Denis Musson souligne qu'un juriste interne sera plus au fait des problématiques de son entreprise qu'un cabinet de conseil. "De plus, avec le risque juridique en croissance, les entreprises ont besoin en interne de quelqu'un dont c'est le premier souci", avertit Christophe Roquilly.
D'autant plus que le droit peut être un avantage compétitif: "Le juriste permet d'éviter les risques, mais aussi de trouver des opportunités de développement", estime Denis Musson. Il donne l'exemple des actions de groupe, les fameuses "class actions" américaines, qui permettent à des consommateurs s'estimant victimes d'une même fraude de la part d'une entreprise de se regrouper pour obtenir réparation de leur éventuel préjudice. Adoptées en février dernier par le Parlement, elles devraient se développer en France: "Il s'agit de prendre les précautions qui s'imposent. Ce qui peut représenter une opportunité pour les entreprises qui s'y préparent", insiste le président du Cercle Montesquieu.
Une couverture juridique efficace est essentielle pour les risques auxquels est soumise toute entreprise en croissance. Lorsque les besoins de l'entreprise le justifient, le Daf doit savoir externaliser la gestion juridique à un cabinet spécialisé, voire procéder à un recrutement en interne.
13 [Témoignage] Sam Outillage recrute un responsable juridique
Chez Sam Outillage, cela fait sept mois que l'on s'active pour trouver un responsable juridique. Le secrétaire général de la société, qui s'occupait de cette problématique, va bientôt partir à la retraite. Et pas question d'externaliser totalement la fonction juridique!
"L'environnement est de plus en plus juridique: un risque mal géré peut faire couler la société. Et les cabinets externes sont chers", explique Sandy Zito, le Daf. D'autant plus que, comme toute entreprise innovante, Sam Outillage est exposée à des problématiques de brevets.
"Par ailleurs, notre type d'activité nous impose d'avoir un oeil sur les contrats clients. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous alerte sur les risques que nous prenons", explique le Daf, soulignant que les contrats qui faisaient hier deux pages dépassent aujourd'hui la centaine de pages. La recherche du responsable juridique devrait bientôt aboutir: 40 CV ont déjà été reçus et les entretiens débutent tout juste. L'entreprise espère accueillir son responsable juridique à l'été 2014.
Sandy Zito, Daf de Sam Outillage, revient sur le recrutement du responsable juridique de la société.
14 Quels impératifs juridiques pour le Daf en 2014?
Les PME sont - depuis plusieurs années - confrontées à une équation difficile face à l'évolution et à l'inflation des règles et des normes. Elles ne profitent, pour ainsi dire, d'aucune des mesures de simplification du droit, essentiellement tournées vers les TPE, les auto-entreprises et autres micro-entreprises (ces sociétés et entreprises permettant notamment de ne pas alourdir les statistiques du chômage). Elles ne bénéficient pas non plus des moyens et des ressources propres aux grands groupes, cotés ou non, pour gérer cet afflux de textes. Les années 2013 et 2014 n'ont pas modifié cette donne, loin s'en faut, et les nouveaux points de vigilance sont nombreux.
15 1. Droit fiscal
En matière de droit fiscal tout d'abord, il convient, depuis le 1er janvier 2014, d'être attentif aux intérêts versés aux sociétés étrangères. S'ils ne sont pas soumis à un taux d'imposition théorique d'au moins 8,33% (33,33 x 25%) chez la société créancière, ils ne sont plus déductibles chez l'emprunteur.
De son côté, le régime d'imputation des déficits réalisés à l'étranger prévu par l'article 209 C du CGI est supprimé. Il permettait aux PME de déduire de leur résultat imposable les déficits de leurs succursales ou filiales implantées à l'étranger. La cotisation minimum dont sont redevables les assujettis à la CFE a quant à elle été aménagée (trois tranches supplémentaires dont deux entre 0 et 100 000 euros). L'assiette de la taxe sur les salaires a en outre été modifiée: la nouvelle assiette exclut les gains tirés de la levée d'options sur les actions et les gains d'acquisitions gratuites d'actions.
Concernant les droits de mutation à titre onéreux, les conseils départementaux ont la faculté, pour les ventes intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, d'augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dans la limite d'un plafond de 4,50% (soit un taux global maximum de 5,80665%). La quasi-totalité des départements a voté cette augmentation (à l'exception notable des départements 75, 78 et 95).
À noter également, la création d'un nouveau PEA dit "PME-ETI". Il fonctionne de la même manière que le PEA "classique" à l'exception de deux points: d'une part, le plafond des versements est de 75 000 euros, et seules les actions et parts émises par des entreprises européennes de taille intermédiaire sont concernées; d'autre part, les parts ou actions d'OPCVM sont éligibles. Les deux PEA sont cumulables.
16 2. Droit social
En sus des augmentations des plafonds et taux de cotisations, réévalués, comme chaque année, au 1er janvier, on note trois réformes importantes:
- La réforme des règles applicables au licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés sur une période de 30 jours entraîne tout d'abord une modification des délais dans lesquels le comité d'entreprise doit être consulté et doit rendre son avis. Pour les procédures de licenciement collectif dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité d'entreprise doit tenir au minimum deux réunions espacées d'au moins 15 jours (art. L.233-30 du code du travail). Il doit, par ailleurs, rendre ses avis dans un délai qui ne peut pas être supérieur, à compter de la première réunion :
- à 2 mois pour un nombre de licenciements inférieur à 100 ;
- à 3 mois pour un nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
- à 4 mois pour un nombre de licenciements supérieur à 250.
Le comité d'entreprise est consulté sur l'opération projetée et ses modalités d'application (volet économique) et sur le projet de licenciement collectif (volet social). En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, il est réputé avoir rendu un avis. Le comité d'entreprise peut recourir à l'expert-comptable, qui doit rendre son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai imparti au CE pour rendre ses deux avis.
La réforme entraîne aussi un changement de l'accord collectif majoritaire ou du document unilatéral de l'employeur. Le plan de sauvegarde de l'emploi et la procédure doivent faire l'objet d'un accord collectif "majoritaire", d'un document unilatéral de l'employeur ou d'une combinaison des deux dispositifs. Elle transfère en outre à la Direccte le contrôle de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et celui du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. L'accord majoritaire et/ou le document unilatéral lui sont transmis pour validation ou homologation. Cette dernière peut par ailleurs intervenir à tout moment de la procédure pour formuler des observations.
- En matière de travail à temps partiel, la loi de sécurisation de l'emploi du 24 juin 2013 a fixé la durée minimale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (art. L.3123-14-1 du code du travail). Toutefois, une durée de travail inférieure peut être prévue sur demande écrite et motivée du salarié (art. L 3123-14-3 du code du travail) ou par convention ou accord de branche étendu (art. L.3123-14-3 du même code). À ce jour, les entreprises de la propreté et de l'édition pourront déroger à la durée minimum légale.
Conformément à l'art. 12 de la loi du 14 juin 2013, ces dispositions devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Cependant, en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'application de ces dispositions a été suspendue jusqu'au 30 juin 2014, afin de permettre la négociation de conventions ou d'accords de branche étendus prévue à l'art. L.3123-14-3. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre du même article, la durée minimale de 24 heures s'applique au salarié qui en fait la demande. L'employeur a la faculté de refuser si cela est justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
La loi met également en place un système de "complément d'heures" par lequel les conventions ou accords de branche étendus peuvent prévoir la possibilité de conclure un avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Des changements sont aussi apportés en ce qui concerne la rémunération des heures complémentaires.
- À noter également, l'allongement du délai de carence prévu par l'assurance chômage. En cas de licenciement (ou de rupture conventionnelle), Pôle emploi ne verse d'allocation-chômage qu'après un délai de carence. Ce délai prend en compte un différé d'indemnisation (sept jours), les jours de congés payés ainsi que le montant des indemnités de rupture perçues par le salarié.
À compter du 1er juillet 2014, le plafond du délai de carence lié aux indemnités de rupture passera de 75 à 180 jours. La durée de la carence sera calculée en divisant le montant de l'indemnité de rupture supra-légale par 90. En conséquence, lorsqu'un salarié obtient 16 200 euros à titre d'indemnités supra-légales dans le cadre d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle, il supporte cette carence de 180 jours.
17 3. Droit économique
Sur le plan du droit économique, le texte marquant des mois écoulés est indéniablement la loi Hamon qui, outre l'introduction en droit français de l'action de groupe, comporte toute une série de contraintes nouvelles pour les entreprises.
- Concernant les entreprises du secteur B to C, qui sont au coeur du dispositif, les nouveaux textes renforcent fortement les obligations d'information (précontractuelle et contractuelle) du consommateur, l'alourdissement étant encore plus sensible en matière de vente à distance et spécialement de vente par Internet.
Très concrètement, et dans la mesure où il appartient au professionnel de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations légales, les entreprises du B to C vont devoir, pour celles qui ne l'ont pas déjà fait, envisager très sérieusement la rédaction et la mise à disposition de conditions générales de vente. Celles qui en ont déjà un devront le mettre à jour des nouveautés (par exemple, l'obligation de reproduire intégralement les textes concernant la garantie de conformité et celle contre les vices cachés et de préciser le délai de disponibilité des pièces détachées). La DGCCRF pourra désormais réaliser des "enquêtes mystères" (i. e. sans que l'agent soit contraint de décliner d'emblée ses qualités) pour vérifier le respect de ces règles.
- Concernant les entreprises du secteur B to B, on mentionnera l'augmentation spectaculaire des sanctions applicables en cas de non-respect des délais de paiement. Le non-respect des délais légaux (inchangés), comme le fait de retarder abusivement leur point de départ, est désormais sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros (doublée en cas de réitération). La DGCCRF a d'ores et déjà annoncé qu'au moins 1 500 entreprises allaient être contrôlées sur l'année 2014.
À noter aussi de nouvelles contraintes dans la relation fournisseur/distributeur, avec un renforcement sensible du formalisme entourant les négociations annuelles: les CGV et le tarif de base doivent être communiqués au distributeur avant le 1er décembre de chaque année, soit au moins trois mois avant la date limite de signature de la convention annuelle. Celle-ci doit par ailleurs désormais préciser les réductions de prix consenties au distributeur à l'issue de la négociation et la rémunération des services de coopération commerciale, ce qui signe définitivement l'arrêt de mort de la négociation "en triple net" que pratiquent toujours de nombreuses PME. Les sanctions sont très lourdes: le fait de ne pas justifier avoir conclu dans les délais une convention annuelle conforme est désormais sanctionné par des amendes administratives pouvant atteindre 375 000 euros (doublées en cas de réitération). La DGCCRF a annoncé que les enquêtes débuteraient dès le 1er mars 2015.
Les nouveaux taux de TVA
- Le taux normal de 19,6% est passé à 20%, le taux intermédiaire de 7% est passé à 10% (ce taux est étendu aux opérations de construction de logements intermédiaires).
- Le taux spécifique de 8% applicable en Corse est passé à 10%, le taux réduit de 5,5% a été étendu à diverses activités.
18
Par les avocats de Racine
Frédérique Chaput et Valérie Ledoux, avocates associées - département concurrence-distribution;
Luc Pons, avocat associé - département droit des sociétés-fusions acquisitions ; Fabrice Rymarz, avocat associé - département fiscal; Stéphanie Raquillet et Sarah Usunier, avocats, directeurs de mission - département droit social.
Racine est un cabinet d'avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit près de 130 avocats ou juristes. Ses avocats interviennent pour des PME et des grandes entreprises issues de différents secteurs de l'industrie et des services, pour des organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que pour des collectivités publiques. Leurs compétences couvrent les domaines suivants: agroalimentaire, arbitrage, concurrence/distribution, douanes, droit commercial et économique, droit de l'environnement et fiscalité environnementale, droit fiscal, droits de l'homme, droit patrimonial et de la famille, droit pénal général et des affaires, droit public et droit administratif, droit social, financement, fusions-acquisitions/droit des sociétés, immobilier/construction, propriété Intellectuelle et industrielle, restructuring, transports et logistique.
La multiplication de nouveaux textes de loi ces derniers mois peut compliquer la tâche du Daf, qui doit jongler avec des impératifs juridiques toujours plus nombreux, notamment en l'absence de responsable juridique attitré dans l'entreprise. Panorama des principaux points de vigilance.
19 [Interview d'Olivier Chaduteau, Day One] " Le Daf et le directeur juridique ne doivent pas être en concurrence "
Dans votre dernier ouvrage "La Direction juridique de demain", vous constatez un changement de paradigme du droit en entreprise. Quelle conséquence pour la fonction juridique?
La direction juridique est en train de changer radicalement de positionnement et de forme. Depuis une quinzaine d'années, de plus en plus d'entreprises sont dotées d'une fonction juridique. Cette évolution est à la fois quantitative et qualitative. Bien sûr, cela concerne les grands groupes, mais aussi les ETI et les PME.
Il y a une raison à cela: le juridique est tellement imbriqué dans l'économique que l'on ne peut plus faire des affaires sans faire de droit. Dès lors, soit on perçoit le droit comme étant un coût, un frein qui empêche d'avancer, soit on estime - et c'est là l'hypothèse de mon livre - que le droit doit être un outil de compétitivité. Pour s'en convaincre, il suffit par exemple de voir comment Apple monétise sa propriété industrielle grâce à la vente de licences et de brevets.
Cette nouvelle donne influe-t-elle sur les places respectives du Daf et du directeur juridique?
Dans une PME où le Daf s'occupe également des questions juridiques, celui-ci risque de se retrouver dans des situations où les deux casquettes seront en opposition d'intérêts. Car certains projets peuvent être bons pour les résultats de l'entreprise, mais risqués sur le plan juridique. Or, s'il détecte un risque majeur, le responsable juridique doit s'opposer fermement. Le rôle du droit en entreprise est de protéger la personne morale.
À partir d'une certaine taille d'entreprise et d'un certain niveau de risque, il faut que la fonction juridique soit bien distincte et qu'elle fasse son reporting directement à la direction générale. J'ai l'habitude de dire que la direction juridique doit devenir le bras gauche du dg.
Comment le Daf et le directeur juridique doivent-ils collaborer?
La direction financière et la direction juridique ne doivent pas être en concurrence. Les deux travaillent en vue du développement de l'entreprise, mais elles n'ont simplement pas les mêmes lunettes. La direction générale a besoin d'avoir le point de vue objectif des deux pour prendre une décision adaptée.
Aujourd'hui, le responsable juridique devient un business partner dont le rôle est de participer à la croissance de l'entreprise. Mais il reste en même temps le gardien du temple sur le plan du droit. Il n'est plus seulement là pour rédiger un contrat ou gérer un contentieux. Il doit pouvoir identifier les opportunités de business liées à l'évolution de la réglementation. Cela signifie qu'il doit être capable de comprendre l'économie, le secteur et la stratégie de l'entreprise, mais aussi de lire un bilan, un compte de résultat et comprendre les problématiques de la direction financière.
Sur le plan opérationnel, il faut que ces deux fonctions soient moins cloisonnées, ce qui nécessite de casser les silos. Elles vont devoir échanger de plus en plus, car le pouvoir n'est pas dans les mains de celui qui jargonne dans son coin. Cela implique que chacun se forme pour mieux comprendre l'autre.
À lire
"La Direction juridique de demain - vers un nouveau paradigme du droit dans l'entreprise" est édité par Lextenso. Cet ouvrage de 248 pages est disponible en librairie au prix de 25 euros.
Pour aller plus loin...
[Dossier] La direction administrative et financière et l'organisation interne de l'entreprise
Si Daf et directeur juridique peuvent se trouver en opposition d'intérêts sur certains sujets, Olivier Chaduteau, associé fondateur du cabinet de conseil en stratégie Day One (Paris), estime que ces deux fonctions, complémentaires, peuvent collaborer de façon constructive.
Sur le même thème
Voir tous les articles Droit des affaires







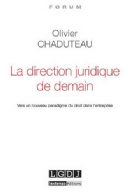
![Les 100 premiers jours post-acquisition : construire un [...]](https://cdn.edi-static.fr/image/upload/c_lfill,h_201,w_298/e_unsharp_mask:100,q_auto/f_auto/v1/Img/BREVE/2025/9/485052/100-premiers-jours-post-acquisition-construire-partenariat-gagnant-fonds-investissement-L.jpg)