Facturation électronique : e-invoicing, e-reporting, comment réussir la mise en oeuvre ?
Lors de la Journée Invoicing Day organisée par ICD International à Paris ce mardi 1er juillet, les enjeux et impacts de la réforme de la facturation électronique pour les entreprises ont été décryptés par Mathias Parnaudeau, expert E-Invoicing & Dématérialisation chez ICD International.

La réforme de la facturation électronique introduit des changements majeurs dans les processus "métiers" des entreprises. La direction financière est d'autant plus impactée qu'elle gère les entrées des fllux financiers en amont et aval de la facturation. Comment se préparer au mieux à cette réforme ? Quels sont les principales étapes et points clés à connaître ? Réponses.
Contexte réglementaire et échéances clés
La réforme de la facturation électronique, marquée par deux dates majeures (1er septembre 2026 et 1er septembre 2027), impose des obligations distinctes selon la taille des entreprises. Dès 2026, toutes les entreprises, y compris les grandes entreprises et les ETI, seront tenues de recevoir des factures électroniques. L'obligation d'émission concernera quant à elle les PME et TPE à partir de 2027.
Mathias Parnaudeau, expert E-Invoicing & Dématérialisation ICD International, a tenu a rappelé que cette réforme s'articulait autour de trois enjeux principaux. L'e-invoicing qui concerne exclusivement la facturation domestique entre entreprises assujetties à la TVA en France. L'e-reporting qui est le mécanisme de déclaration des opérations d'achat/vente à l'international et des ventes aux particuliers, distinct du processus de facturation. Et les cycles de vie qui permettent de suivre l'évolution des factures, avec des statuts minimaux imposés par le législateur.
E-invoicing et e-reporting, quelles différences ?
Il existe une confusion fréquente entre ces deux mécanismes pourtant bien distincts de la réforme de facturation électronique. « L'e-reporting constitue une fonction purement déclarative auprès de l'administration fiscale qui ne concerne pas la transmission des factures entre entreprises, mais permet uniquement de rapporter les opérations commerciales à l'autorité fiscale. L'e-invoicing, en revanche, transforme fondamentalement les processus d'émission et de réception des factures. Ce mécanisme implique à la fois la transmission des factures aux clients et leur déclaration à l'administration », précise Mathias Parnaudeau. Contrairement à l'e-reporting, l'e-invoicing modifie donc concrètement les pratiques actuelles de facturation en imposant de nouveaux formats et canaux de transmission.
La complexité de l'e-reporting dans la réforme
L'e-reporting représente l'aspect le plus complexe et le moins clairement défini de la réforme de facturation électronique. « Ce mécanisme vise à collecter l'ensemble des informations relatives aux transactions internationales, tant en termes d'achats que de ventes, ainsi que la totalisation des ventes réalisées auprès des particuliers. Il s'agit d'un système déclaratif distinct du processus de facturation lui-même, nécessitant l'échange de fichiers structurés contenant les données des opérations commerciales », détaille Mathias Parnaudeau.
Contrairement à l'e-invoicing qui transforme les processus d'émission et de réception des factures, l'e-reporting se concentre exclusivement sur le reporting des opérations à l'administration fiscale. « Les données requises pour ce reporting sont moins détaillées que celles nécessaires à l'e-invoicing, mais couvrent néanmoins l'ensemble des informations de facturation et de transaction. Ces données doivent être transmises au concentrateur fiscal selon une périodicité trimestrielle, regroupées par nature d'opération et identifiant d'entreprise (SIREN ou SIRET) ».
Le rôle des PDP dans l'e-reporting
Les PDP jouent un rôle crucial dans la mise en oeuvre de l'e-reporting. « Elles ne se contentent pas de transmettre les données, mais assurent également leur concentration, leur agrégation et leur contrôle de conformité avant transmission au concentrateur fiscal », explique l'expert. Cette fonction va au-delà de la simple remise des données, incluant une vérification de la cohérence et de la qualité des informations déclarées.
Les entreprises doivent s'appuyer sur leur PDP pour assurer la conformité et la transmission des données. Cette collaboration nécessite une préparation en amont, notamment via un audit des flux, afin d'identifier les données à collecter et à agréger pour chaque période déclarative.
Les cas métiers spécifiques et leurs implications
La réforme soulève de nombreuses questions concernant les cas métiers spécifiques. « Certains secteurs d'activité présentent des particularités qui nécessitent une attention particulière. Par exemple, dans le cas de la gestion mandataire, où les factures sont adressées à la fois au destinataire réel et au mandataire payeur, la réforme impose de nouvelles contraintes », indique Mathias Parnaudeau.
L'autofacturation et ses défis
L'autofacturation représente un autre cas métier complexe. « Que ce soit pour les fournisseurs ou les clients, ce processus nécessite une attention particulière dans le cadre de la réforme. Les entreprises doivent s'assurer que leurs systèmes sont capables de gérer ces cas spécifiques, qui peuvent impliquer des données complémentaires ou des cycles de vie particuliers », souligne l'expert.
L'évolution des normes et des groupes de travail AFNOR
La réforme est en constante évolution, avec des groupes de travail tels que ceux constitués par les commissions AFNOR qui oeuvrent à la redéfinition des cas métiers et à l'adaptation des normes. « Ces travaux visent à compléter et à clarifier les exigences de la réforme, en collaboration avec les PDP et les différents acteurs concernés », précise-t-il.
Cette dynamique souligne « l'importance pour les entreprises de rester informées des évolutions et de s'adapter en conséquence, afin de garantir une conformité continue avec les exigences réglementaires en constante mutation », conclut-il.
Sur le même thème
Voir tous les articles Normes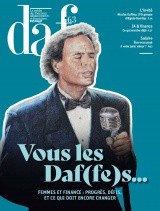

![Prévention de la fraude : le rôle clé des contrôleurs et [...]](https://cdn.edi-static.fr/image/upload/c_lfill,h_201,w_298/e_unsharp_mask:100,q_auto/f_auto/v1/Img/BREVE/2025/7/484169/prevention-fraude-role-cle-controleurs-auditeurs-internes-L.jpg)





