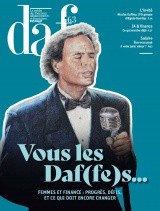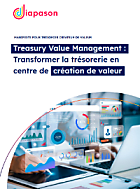CSRD 2025 : quels enseignements de ces 50 premiers reporting "vague 1" ?
Alors que les premières entreprises soumises à la directive CSRD viennent de publier leurs premiers rapports de double matérialité, une étude menée par KPMG sur 51 reporting d'entreprises clientes offre un retour d'expérience intéressant sur la mise en oeuvre concrète de ces nouvelles obligations européennes. Quels enjeux, quels enseignements pour les reporting des entreprises des vagues 2 et 3 ? Décryptages.

Après un long épisode politique au niveau européen et français, les lois Omnibus I et Ddadue ont finalement repoussé l'entrée en vigueur des directives CSRD et CS3D pour certaines entreprises, en dessous du seuil des 1 000 salariés. Les grands groupes, quant à eux, avaient déjà entamé leur travail de reccueil des données extra-financières pour l'exercice 2024 et ont donoc publié leur reporting de double matérialité depuis ce début d'année 2025.
Le cabinet d'audit KPMG en France a mené une étude en se basant exclusivement sur des données issues de projets CSRD accompagnés ou audités par ses équipes auprès de 51 entreprises clientes. Leurs experts reviennnent en détail sur les premiers enseignements de cette première vague.
Une directive exigeante, mais adaptée à la pertinence des enjeux
Tout d'abord, la norme CSRD, notamment via le principe de double matérialité, permet de concentrer le reporting sur les données réellement significatives. En moyenne, 627 data points ont été identifiés par les entreprises, mais ce chiffre est ramené à environ 400-450 grâce à l'approche sélective de la double matérialité. Cela contribue à alléger la charge de travail tout en améliorant la qualité des informations publiées. Or, ce point était très controversé au début de la séquence de la réforme de la directive de double matérialité.
Pour Ghislain Boyer, associé, Advisory - Centre d'Excellence ESG et porte-parole de cette étude, il est important de rappeler « que la double matérialité a été globalement adoptée par les entreprises sans susciter de rejet. D'autre part, elle présente un intérêt pratique en agissant comme un filtre pour réduire la volumétrie des informations à publier. Sur les 400 à 450 informations résiduelles à produire, la majorité - environ deux tiers - concerne des données qualitatives, telles que l'existence d'une politique d'adaptation au changement climatique, qui ne nécessite pas une actualisation fréquente. La part véritablement quantitative, liée aux données chiffrées, ne représente qu'un tiers de l'ensemble », nous rappelle-t-il.
Des entreprises engagées en faveur de la CSRD
« A savoir que 100 % des déclarants à la CSRD ne se sont pas engagés dans cette démarche uniquement en réponse à une obligation réglementaire. En effet, les motivations sous-jacentes relèvent de considérations de réputation, de relation avec la clientèle et de relation avec les investisseurs. En somme, si certains acteurs ont choisi d'adopter la CSRD de manière anticipée, sans y être encore contraints par la réglementation, c'est parce qu'ils ont compris qu'il s'agissait d'un enjeu de création et de préservation de la valeur de l'entreprise », ajoute Jérémie Joos associé, co-responsable du Centre d'Excellence ESG chez KPMG en France. Et cette réalité se reflète dans un grand nombre des projets des entreprises clientes du cabinet, « ainsi que dans les discussions que nous poursuivons avec nos clients qui, soit dépassent désormais les seuils d'application de la CSRD, soit bénéficient encore d'un délai de deux ans, mais qui nous déclarent néanmoins vouloir continuer », indique-t-il.
Trois thèmes ESG dominent les rapports
Parmi les 38 thématiques couvertes par les ESRS, certaines se démarquent comme largement prioritaires pour les entreprises :
-Égalité de traitement (S1) - matériel pour 96 % des organisations,
- Atténuation du changement climatique (E1) - 92 %,
- Lutte contre la corruption (G1) - 84 %.
À l'inverse, des sujets comme la pollution par microplastiques ou la gestion des ressources marines restent peu traités, ce qui témoigne de leur moindre pertinence dans de nombreux secteurs.
Ces résultats attendus s'expliquent en grande partie par le contexte français, explique Jérémie Joos. En effet, la France dispose d'une culture du reporting de durabilité bien ancrée, avec près de vingt ans d'expérience, en particulier pour les entreprises cotées. « Cette maturité s'est construite grâce à des réglementations spécifiques : droit du travail pour les enjeux sociaux, lois et initiatives environnementales pour le climat, et la loi Sapin pour la lutte contre la corruption. Les entreprises françaises étaient donc mieux préparées et plus structurées pour aborder ces sujets, ce qui explique qu'ils soient remontés rapidement comme matériels », rappelle-t-il. Il serait intéressant de comparer cette dynamique à d'autres pays européens, notamment pour évaluer si les thèmes de corruption et de responsabilité sociale y sont aussi prégnants. Ce contexte montre par ailleurs que, malgré ses contraintes, « la réglementation contribue à élever le niveau de maturité des organisations et peut, à terme, devenir un véritable avantage compétitif », analyse-t-il.
Une mobilisation interne entre Daf et RSE
Seulement 45 % des projets CSRD sont aujourd'hui pilotés par les équipes RSE. L'implication de la gouvernance, bien que cruciale, reste jugée « moyenne » dans plus de la moitié des cas. Cette implication conditionne pourtant la capacité de l'entreprise à arbitrer efficacement et à déployer une stratégie durable ambitieuse.
Toutefois, les projets ont été menés avec plus de succès lorsqu'une collaboration étroite existait entre la direction financière et la direction RSE. « Le soutien du CFO, notamment dans les entreprises cotées, a joué un rôle clé grâce à sa capacité à dialoguer avec les auditeurs et à maîtriser les outils de reporting et de données », précise Ghislain Boyer. Cette complémentarité n'aurait cependant pas été possible sans l'expertise de la direction RSE sur les sujets environnementaux, sociaux et, dans une moindre mesure, de gouvernance. « Cet exercice a ainsi contribué à désiloter les organisations en obligeant différentes directions, parfois éloignées du reporting ou des enjeux ESG, à travailler ensemble. De plus, la convergence attendue entre données financières et extra-financières, notamment sur la gestion des risques climatiques ou autres, justifie l'implication active de la direction financière dès les premières étapes du projet », complète-t-il.
Des difficultés opérationnelles persistantes
Selon l'étude, la collecte de données s'impose comme le principal point de blocage : 65 % des entreprises font état de fortes difficultés, en particulier sur la chaîne de valeur (Scope 3). Les freins majeurs sont liés à la fiabilité des données fournisseurs, l'absence de standards partagés et à la décentralisation des organisations.
Sauf cas exceptionnels, les entreprises n'ont pas découvert de nouveaux impacts ou risques. Toutefois, l'exigence de divulgation associée à ces risques ou impacts a mis en évidence des faiblesses ou des angles morts, notamment l'absence de politiques, de plans d'action ou d'objectifs formalisés pour y répondre. « La double matérialité a donc été perturbante non par la révélation de nouveaux enjeux, mais par la prise de conscience du manque de dispositifs pour les gérer. Par ailleurs, cette approche a élargi la réflexion aux chaînes de valeur, soulevant des défis supplémentaires liés à la collecte de données fiables et hétérogènes, ce qui a parfois déstabilisé certaines entreprises », souligne Jérémie Joos.
Une question de compétitivité à ne pas négliger
Pour une ETI, la démarche CSRD relève d'un enjeu de compétitivité hors prix. Un exemple concret illustre ce point pour Jérémie Joos. « Une entreprise réalisant environ 750 millions d'euros de chiffre d'affaires a lancé son projet CSRD dès janvier 2023, non par obligation réglementaire, mais parce que ses principaux clients l'exigeaient. Ceux-ci ont clairement indiqué que l'absence de transmission des informations demandées remettrait en cause son maintien dans leurs panels fournisseurs ». La CSRD est perçue « non seulement comme une réponse aux attentes réglementaires, mais aussi comme un levier essentiel pour répondre aux exigences des clients, investisseurs et actionnaires, influençant directement les décisions commerciales ». Ce contexte a conduit d'autres entreprises à accélérer également leurs démarches, notamment en matière de décarbonation ajoute l'expert.
Des secteurs à des niveaux de maturité inégaux
Les secteurs les plus avancés en matière de reporting CSRD sont l'Agroalimentaire, Utilities, et Automobile, qui identifient jusqu'à 10 ESRS matériels en moyenne, tandis que la moyenne tous secteurs confondus s'élève à 7.
Les industries confrontées à des thématiques plus techniques (pollution, biodiversité, relations avec les communautés) rencontrent davantage de difficultés à produire des reportings robustes.
Une première étape décisive
Ce premier exercice CSRD révèle la profondeur des transformations à mener : revoir la gouvernance, structurer les données, investir dans des outils adaptés. La directive ne se limite pas à une obligation réglementaire. Elle s'impose comme un catalyseur stratégique, révélateur de la capacité des entreprises à piloter leur performance durable. Et dans les entreprises de taille intermédiaire, souvent dépourvues de direction RSE ou de ressources dédiées à chaque sujet, la gestion de projet autour du directeur financier revêt une importance particulière. « Il existe un réel intérêt à aligner la stratégie, les financements et les enjeux de durabilité, cette articulation étant naturellement portée par la direction financière. Si celle-ci ne s'en charge pas, il est difficile d'imaginer qui pourrait le faire. Dès lors, cette dynamique représente également une opportunité individuelle de valoriser et de recentrer le rôle de la direction financière au sein de l'organisation, ce qui paraît, dans bien des cas, une évidence », conclut Ghislain Boyer.
Sur le même thème
Voir tous les articles Finance durable