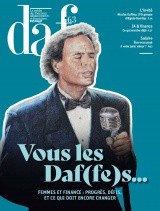CSRD et compétitivité : quels enjeux pour les PME ?
L'application de la CSRD a été repoussée dans le temps pour certaines entreprises, vague 2 et PME cotées (vague 3), les autres PME ne seraient plus concernées par l'obligation. Des différences qui soulèvent encore de nombreuses questions en termes de compétitivité. La rédaction a rencontré Alexandre Rambaud, maître de conférences à AgroParisTech-CIRED, codirecteur des chaires « Comptabilité Ecologique » et « Double Matérialité » pour évoquer les enjeux qui en découlent.

Le projet de directive Omnibus dite « Stop the clock », a été adopté le 3 avril dernier par le Parlement européen et prévoit de reporter de deux ans l'obligation d'établir un rapport de durabilité pour les entreprises des vagues 2 et 3. Au niveau français, le projet de loi DDADUE a également été définitivement adopté par le Parlement à la même date, et reporte lui aussi de deux ans cette obligation. De son côté, l'EFRAG (Groupe consultatif européen sur l'information financière) a reçu le mandat officiel de la part de la Commission européenne de réviser les normes ESRS du « set 1 » et de rendre un avis technique sur le sujet de la simplification des ESRS avant le 31 octobre 2025.
Toutefois, des questions demeurent, notamment pour les entreprises de la vague 2 soumises au reporting en 2028 (pour l'exercice 2027) et les PME cotées (vague 3) en 2029 (pour l'exercice 2028), et les autres PME qui pourraient s'en tenir à la Norme Volontaire pour les PME (VSME), moins contraignante. Où en sommes nous dans le parcours législatif européen ? Quels en sont les enjeux pour les PME ? Eléments de réponses avec Alexandre Rambaud, maître de conférences à AgroParisTech-CIRED, codirecteur des chaires « Comptabilité Ecologique » et « Double Matérialité ».
Avec la loi Omnibus (Stop the clock), la Commission européenne a finalement repoussé la CSRD selon la taille de l'entreprise. La loi DDADUE en France a suivi. Quels sont les prochaines étapes réglementaires ?
Alexandre Rambaud : Nous sommes actuellement engagés dans un processus structuré en deux phases distinctes. La première porte sur le périmètre d'application et les modalités de report, éléments déjà bien définis et constituant une étape préalable, certes importante, mais essentiellement technique. La seconde phase, attendue pour la fin de l'année, relève quant à elle du législateur et portera sur des évolutions de fond. C'est à ce moment-là que s'ouvriront de véritables débats susceptibles de soulever des interrogations substantielles quant à l'orientation et aux implications du dispositif dans son ensemble.
Quels sujets sont encore en débat d'ici la fin d'année au niveau européen ?
A. R. : A mon sens la question d'une éventuelle remise en cause de la double matérialité demeure à ce jour non tranchée et dans un certain flou. Le sujet reste en suspens, et aucune orientation définitive n'a encore été clairement exprimée. Une remise en cause frontale paraît improbable. En revanche, des évolutions plus subtiles, mais tout aussi significatives, pourraient survenir et pourquoi pas une redéfinition de la notion de double matérialité ou un affaiblissement de sa portée opérationnelle et technique est envisageable.
Un autre point d'attention concerne le dispositif VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs), élaboré pour les PME sur une base volontaire. Or, ce référentiel repose sur une logique de matérialité simple, ce qui suscite certaines préoccupations. En effet, si les PME adoptent massivement ce cadre, cela pourrait induire, par effet de glissement, une tendance à considérer la matérialité simple comme suffisante au regard des exigences de transparence sur les chaînes de valeur. Dès lors, le risque serait de voir la double matérialité rejetée à l'arrière-plan, au profit d'une approche simplifiée, réintroduite de manière indirecte via les normes volontaires. Une telle dynamique pourrait progressivement éroder le principe même de double matérialité, pourtant au coeur du dispositif initial.
Quels en sont les enjeux pour les PME cotées ?
A. R. : Les discussions en cours portent notamment sur l'effectivité de l'application de la CSRD aux PME cotées, dont l'inclusion dans le périmètre réglementaire reste encore incertaine. Plusieurs mécanismes, tels que des relèvements de seuils, pourraient en réduire la portée effective. Parallèlement, le développement de référentiels volontaires comme le VSME basé sur une logique de matérialité simple, soulève des interrogations. En effet, même si certaines PME cotées demeurent soumises à une obligation de reporting (LSME), le rapprochement progressif entre le cadre volontaire et le cadre obligatoire pourrait créer une dynamique de convergence vers des exigences allégées.
Au-delà des PME, les implications de cette évolution se feront également sentir chez les grandes entreprises, notamment en ce qui concerne la collecte d'informations sur leurs chaînes de valeur. Ces dernières risquent de se heurter à une difficulté opérationnelle majeure : si leurs fournisseurs ou partenaires, souvent des PME, ne leur transmettent que des données fondées sur la matérialité simple, elles pourraient se retrouver dans l'incapacité d'alimenter correctement leur propre analyse de double matérialité.
Ne va-t-il pas se poser une question de compétitivité pour ces PME ?
A.R. : L'un des effets préoccupants de la dynamique actuelle autour de la CSRD réside dans l'émergence d'une distorsion entre entreprises en matière de qualité et de niveau d'informations extra-financières. En l'absence de cadre commun rigoureux et clairement stabilisé, certaines organisations, plus avancées ou plus volontaristes, seront en mesure de produire des données de haut niveau, tandis que d'autres, moins engagées, se contenteront d'un socle minimal.
Ce constat met en lumière un point central : la logique même de la norme, dans son rôle structurant, est fragilisée. Une réglementation bien conçue définit des règles communes, applicables à tous, créant ainsi un espace cohérent de conformité et de comparabilité. Or, ce que l'on observe actuellement, c'est une évolution vers un éclatement du cadre de référence.
Il se dessine ainsi plusieurs régimes de fonctionnement : d'un côté, des entreprises adoptant pleinement la double matérialité, parfois de manière très proactive ; de l'autre, des entreprises qui se limitent à une approche simplifiée, voire à une forme de « matérialité simple renforcée », sans pour autant intégrer véritablement l'exigence de double lecture des enjeux de durabilité.
Quels en sont les risques ?
A. R. : Ce flou grandissant engendre des incertitudes opérationnelles majeures, à la fois pour les entreprises et pour leurs parties prenantes. Les grandes entreprises pourraient, par exemple, choisir leurs partenaires en fonction de leur capacité à fournir des données conformes aux exigences de double matérialité, ce qui pourrait exclure du jeu économique des acteurs moins outillés. Inversement, certaines entreprises pourraient considérer la double matérialité comme non pertinente dans leur environnement et s'en détourner, faute d'obligation explicite.
Il en résulterait un spectre d'application élargi, voire une forme de fragmentation, qui fait craindre un retour à un écosystème hétérogène, où chaque acteur définit ses propres seuils, pratiques et référentiels. Cette situation rappelle les dérives antérieures liées à la prolifération des labels ESG privés et à la multiplication des cadres de reporting non harmonisés.
Par ailleurs, un point souvent souligné dans les discussions actuelles est le rôle moteur des investisseurs institutionnels, qui, dans leur grande majorité, se montrent favorables à la CSRD et à la double matérialité. Leur soutien à ce cadre réglementaire s'explique par une volonté d'accéder à une information fiable, structurée et comparable, condition essentielle pour une allocation efficace du capital.
La Chine a, quant à elle, adopté une CSRD proche de celle voulue initialement par l'Europe et le Green Deal, alors que cette dernière a décidé de reculer. Que faut-il en déduire ?
A. R. : Effectivement, ce qui se joue actuellement autour de la CSRD et de la double matérialité dépasse largement le cadre technique ou réglementaire : il s'agit en réalité d'une bataille géopolitique et stratégique de premier plan dans laquelle l'Union européenne avait historiquement affirmé une voie singulière - ce que l'on a souvent appelé la « troisième voie », entre les modèles américain et chinois. Cette orientation repose sur une conception de l'économie fondée non seulement sur la durabilité, mais également sur la recherche du bien commun, dont le Pacte vert constitue un pilier fondamental. La double matérialité s'inscrit pleinement dans cette ambition.
Or, dans ce contexte, la Chine prend une avance significative, et ce pour des raisons éminemment stratégiques. L'engagement chinois en faveur des investissements verts ne relève pas d'un simple affichage : il s'appuie sur une montée en puissance d'une classe moyenne urbaine de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux - notamment à la pollution - mais aussi sur une volonté claire de positionnement international. En devenant leader mondial dans la production de voitures électriques ou de composants pour les énergies renouvelables, la Chine cherche à capituler les chaînes de valeur de l'économie verte. Ce positionnement suppose une orientation des flux de capitaux vers les secteurs considérés comme stratégiques. Autrement dit, la Chine intègre pleinement l'idée selon laquelle la compétitivité passe par le soutien aux innovations d'avenir, et non par la perpétuation des modèles économiques anciens.
Or, pour allouer efficacement le capital, il faut pouvoir disposer d'indicateurs fiables permettant d'évaluer la durabilité réelle des modèles économiques. Historiquement, c'est la comptabilité qui joue ce rôle. Mais si celle-ci reste enfermée dans une logique de rentabilité financière pure, sans prendre en compte les dimensions sociales et environnementales, elle oriente les investissements vers des modèles pourtant non soutenables à long terme.
C'est précisément là que la double matérialité trouve tout son sens : en intégrant l'impact des entreprises sur leur environnement - et non seulement l'inverse -, elle permet une lecture plus juste de la performance globale. Plusieurs groupes d'investisseurs en Asie l'ont d'ailleurs exprimé clairement lors des consultations de l'ISSB : ils ont besoin de repères solides pour orienter leurs choix, et la double matérialité constitue un cadre pertinent pour ce faire.
Quel rôle peut jouer la notion de comptabilité écologique, que vous portez à la chaire éponyme d'AgroParis Tech et au CERCES (Cercle des comptables environnementaux et sociaux), dans le contexte de la CSRD ?
A. R. : Lorsqu'on évoque la comptabilité écologique, il s'agit, dans sa définition la plus fondamentale, d'intégrer dans les systèmes comptables traditionnels des enjeux d'ordre social, environnemental et écologique, au sens large. Cette approche vise à dépasser la seule dimension financière pour prendre en compte les impacts globaux de l'activité économique. Dans cette perspective, la CSRD constitue un jalon structurant, un pas intermédiaire dans une trajectoire plus large qui vise à faire entrer ces dimensions dans le coeur même des dispositifs comptables.
L'objectif à terme est d'aboutir à une comptabilité véritablement intégrée, c'est-à-dire capable de produire des états synthétiques uniques, tels qu'un bilan et un compte de résultat, mais enrichis de dimensions environnementales et sociales. Il s'agit là d'un système complet, englobant également les outils de pilotage et de contrôle de gestion, reposant sur trois piliers fondamentaux : le financier, l'environnemental et le social.
Comment la « comptabilité écologique » intégrée répond-elle aux exigences de la CSRD ?
A. R. : Ce que l'on observe aujourd'hui constitue un avant-goût de ce vers quoi tendent les systèmes comptables, mais la dynamique va désormais bien au-delà, dans la mesure où l'on entre dans une logique unifiée, intégrant dans un même ensemble les dimensions environnementales et financières. Prenons la CSRD, qui marque une montée en puissance de l'exigence comptable dans le champ de la durabilité. Cette directive repose sur une architecture cohérente : d'abord, la fixation d'objectifs scientifiquement fondés, comme le respect d'un budget carbone pour répondre aux enjeux climatiques. Ces objectifs sont ensuite déclinés en plans d'action, que l'on qualifie de plans de transition.
Ces plans sont assortis d'un suivi par indicateurs spécifiques, notamment les émissions de gaz à effet de serre mises en regard des budgets définis. Mais l'élément fondamental, et structurant du point de vue comptable, réside dans le fait que des ressources financières doivent être allouées à ces plans d'action. Autrement dit, on commence à établir un lien direct et opérationnel entre objectifs environnementaux et données financières : les investissements requis, les dépenses engagées, les arbitrages budgétaires.
C'est précisément dans cette articulation que la CSRD, dans sa version actuelle, amorce un basculement : l'enjeu n'est plus simplement de mesurer, mais d'engager, de planifier et de suivre financièrement la transition. Certaines de ces exigences relèvent aujourd'hui d'un cadre obligatoire, d'autres demeurent volontaires, mais la logique sous-jacente est claire : bâtir un cadre de reporting où l'environnement, la stratégie et les finances dialoguent dans une cohérence d'ensemble.
Quels atouts présente-t-elle pour les directions financières ?
A. R. : Malgré les avancées, une partie significative des engagements liés aux enjeux environnementaux ou sociaux demeure encore en dehors des états financiers traditionnels. Ces éléments, bien que stratégiques, restent cantonnés à une forme de « hors bilan », perçus comme relativement flous ou difficilement articulables avec le reste de l'information comptable. C'est précisément à ce point de friction qu'intervient la dynamique de la comptabilité intégrée. Celle-ci propose de refonder le système comptable en élaborant un plan de comptes élargi, doté de rubriques spécifiques permettant de flécher et d'intégrer explicitement les dépenses liées, par exemple, aux plans d'action climatiques.
Ainsi, des investissements engagés pour respecter un budget carbone ou pour accompagner une transition environnementale pourraient trouver une place identifiable dans le bilan et le compte de résultat. Cela permettrait d'associer ces dépenses à des catégories précises, en cohérence avec les objectifs poursuivis par l'entreprise.
Cette comptabilité intégrée, dénommée C.A.R.E. (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology) est aujourd'hui accessible. Elle a été appliquée, par exemple, à des chantiers de Bouygues Habitat Social dans le cadre de plans d'action stratégique. Autre cas : le groupe SLB a obtenu une amélioration significative de sa notation bancaire par la mise en oeuvre de cette comptabilité. D'autres entreprises l'utilisent maintenant dans une logique de suivi à long terme plutôt que d'exercice ponctuel. Parallèlement, des acteurs publics comme le Grand port maritime de La Rochelle restructurent également leur pilotage budgétaire sur cette base, illustrant ainsi l'émergence d'une comptabilité volontaire au service de la stratégie et des décisions d'investissement.
Sur le même thème
Voir tous les articles Finance durable